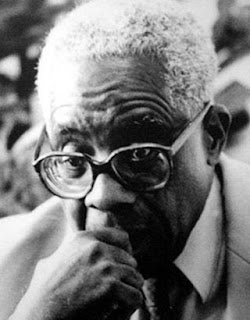Le courrier de Saigon est un journal très différent de l’Indochine enchainée, le premier journal j’ai regardé sur microfilm. Ce journal traite plusieurs nouvelles de l’Asie, et il raconte les nouvelles de France aussi à rapport des colonies.
Le ton de ce journal est opiniâtre : ils nous donnent les nouvelles, mais on reçoit leur avis dans le cadre du rapport aussi. Ce ne sont pas les opinions anticolonialistes, en fait, dans « La véritable école coloniale, » l’auteur défend la colonie en disant que les gens qui veulent préparer pour la vie et les carrières coloniales n’ont pas besoin de partir en France : « il n’a à qu’une seule école coloniale, c’est la colonie. »
On voit la même chose dans deux autres articles, «Protectorat et congrégations, » ou le journal exige la nécessite d’améliorer les écoles et « Fusion nécessaire,» un appel pour un system électorale unifié. En fait, leur priorité est le bien-être de la colonie,--en fait, c’est leur terre, c’est naturel qu’ils veut le mieux pour leur propre propriété, et ils plaident toujours pour le support financière.
Citations intéressants des articles :
La véritable école coloniale (3 janvier 1900): -depuis que les questions coloniales sont de mode en France, il ne se passe pas de jour qui ne soit naitre de nouvelles créations, jardins d’essais, écoles d’agriculture coloniale de commerce colonial, etc. etc. »
-maintenant à paris il y a une « école pratique d’enseignement colonial »
-hélas, nous ne pouvons croire que cette école puisse donner de bons résultats et quoique le directeur de cette institution nous pris, à la fin de sa lettre-circulaire, de bien recommander l’Ecole pratique d’enseignement colonial aux parents qui désirent envoyer leurs enfants en France, nous aurons le regret de ne pas le recommander du tout.
-c’est qu’aux colonies, comme tout partons ailleurs, on ne peut se contenter de connaissances générales et que, seules, les connaissances spéciales ont une valeur.
-un élève qui sortira de cette école n’aura aucune spécialité et par suite ne sera bon a rien. Un commerçant t ne le prendra pas comme comptable parce qu’il ne sera pas comptable, il aura bien appris vaguement ce que c’est qu’une lettre de change, un grand-livre ou un livre-journal mais il sera incapable de tenir une comptabilité parce que c’est une profession et que pour l’exercé il faut l’avoir spécialement étudié.
-un industriel ne le prendra pas davantage parce qu’il n’est ni mécanicien ni forgeron ni chaudronnier ni rien : un planteur n’en voudra pas parce qu’il ne connait ni la culture du riz, ni celle du café ni celle du poivre, ni aucune en particulier, parce qu’il ne connait ni le pays ni ses coutumes, ni les conditions spéciales dans lesquelles s’exécutent les travaux agricoles.
-nous ne saurions donc trop souvent répéter ce qui n’est pas dans les écoles de France qu’non formera les colons. Les parents qui disaient que leurs enfants s’établissent plus tard aux colonies n’ont qu’à se mettre en relation avec des colons et envoyer leurs enfants en apprentissage chez eux.
-au lieu de leur faire passer plusieurs années dans une école spéciale, qu’ils les placent chez un agriculteur, chez un industriel ou chez un commercent des colonises et c’est la seulement en mettant la main a la pate qu’ils appréhendent un métier et pourquoi ensuite s’intéresser, s’associer ou s’établie eux-mêmes.
- le anglais et hollandais et les allemands sait mieux déjà, ils envoient les gens aux colonies.
-il n’a à qu’une seule école coloniale, c’est la colonie.
-quand donc comprend-t-on cela en France ?
Protectorat et congrégations (17 mars 1900): -bien que Phnom-Penh soit pourvu depuis un certain nombre d’années d’une école primaire, laquelle renferme une centaine d’élèves, on ne peut pas dire que le service de l’enseignement soit organisé au Cambodge : en effet, ladite école ne compte qu’un seul professeur européen, M. Flamant, et dans l’intérieur du Cambodge, ainsi que nous avons déjà eu le regret de le dire dans ce journal, rien, pas l’ombre d’une école
- cela n’est pas assez et cette situation appelle des réformes urgentes qui devront s’imposer avant peu, nous voulons le croire, a l’attention du gouvernement général et a celle de m. Luce, résident supérieure.
-nous nous répétons : ou est l’école ? Elle est inexistante.
-non seulement nous trouvons pour le moins étrange que le gouvernement subventionne les béguines du Cambodge pour une école qui n’existe pas, mais nous nous demandons si nos gouvernants ne cherchent pas à appliquer davantage, dans cette colonie, le principes du syllabus plutôt que ceux découlant d’une administration républicaine, quand nous apprenons que les « chères frères des écoles chrétiennes » dont floridien est l’apôtre, ont le cynique doucet de solliciter actuellement la concession gratuite d’un terraient pour construire a pompent une succursale de l’institution Tahert.
-évidemment, notre laïque périclitera, a cote de la puissante congrégation, riche de nos sacrifices et de nos derniers.
Il conviendrait pourtant de savoir si l’on va persévérer, dans cette voie rétrograde et si, a l’heure ou d nombreux scandales éclatent partout, en France, a l’ombre des maison congréganistes, a l’Indochine en général et le Cambodge en particulier seront pour elles un refuge.
Fusion nécessaire (21 mars 1900):-L’administration supérieure a fusionne les séries des divers pays de l’Union et les fonctionnaires, des douanes par exemples, de la Cochinchine, du Cambodge, de l’Annam et du Tonkin sont devenus les agents des douanes de l’Indochine. Est-ce un bien, est-ce un mal, ce n’est pas la le point que nous voulons examiner aujourd’hui, la fusion a eu lieu et il n’a plus à y revenir. Mais elle n’a pas été complète et les élections qui vont avoir lieu prochainement au Cambodge nous ont démontré la nécessité d’une nouvelle fusion : la fusion électorale.
- il se produit en effet ceci : c’est qu’actuellement un très grand nombre de fonctionnaires, cents de douanes et régies en particulier, ne sont pas électeurs et se trouvent en fait privés de leur droit de voter.
-il existe en effet des listes différentes pour la Cochinchine, le Cambodge, l’Annam, et le Tonkin.
-l’établissement d’une liste électorale unique n’entrainerait évidemment pas pour les fonctionnaires en service en Cochinchine le droit de voter pour l’élection du délègue pas plus que les fonctionnaires du Cambodge ne voteraient pour le député de Cochinchine, mais chacune d’eux voterait aux élections qui auraient lieu dans le pays ou ils seraient en service, a la seul condition qu’ils aient six mossi de présence en Indochine moment de l’établissement des listes. Cette réglementation est du reste applicable en France à certaines catégories de fonctionnaires, les prefaits et sous-prefaits par exemple, et rien ne nous parait devoir s’opposer à ce qu’on l’applique, également en Indochine.