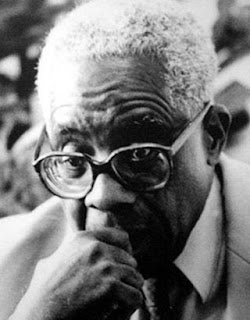« L’odeur de la papaye verte » est un joli film qui rencontre l’histoire de Mui, une jeune vietnamienne qui vient a la maison d’une riche famille vietnamienne. L’histoire est présentée lentement et subtilement, et il y en a plusieurs détails riches qui contribuent à la beauté de l’histoire.
La majorité du filme passe dans l’espace restreint d’une maison : premier la maison d’une grande famille, et deuxièmement la maison du pianiste. Mui est servante, donc c’est logique qu’elle reste dans la maison, mais en observant les maitres on voit que tout le monde est prisonnier d’un sort de la maison. Cette fait devient plus clair quand le père s’échappe de la maison---son départ rend tout le monde à réalisé comment ils sont immobiles dans leur station.
La musique joue un très grand rôle dans « L’odeur du papaye vert. » au début du film, on entend le père de la maison en jouant un instrument traditionnel le soir. C’est clair que cette musique est très important à lui car il ne fait pas trop attention a la mère qui lui parle du fait que leur fils ainé n’as pas encore rentré et la nouvelle servante est arrivé. Son musique, et bien les sons quotidiennes de la vie à la maison sont toujours interrompes par le couvre-feu qui hurle le soir. Même dans cette maison traditionnelle, on ne peut pas oublier qu’il y a une guerre qui les entoure. La musique européenne du pianiste, l’ami du fils ainé et nouveau maitre de Mui, par contre, semble d’effacer le son du couvre feu même dans le tempête, la musique classique règne peut-être c’est un son d’un couvre-feu symbolique---en jouant le piano, le pianiste reste chez lui.
Pouvons-nous identifier avec les personnages ? Ca dépend. Moi, je n’ai jamais été servante et je ne suis pas vietnamienne. Mais en même temps, la souffrance de la famille avec le départ et le mort du père et l’histoire de la servante qui gagne le cœur de son maitre (ou, sa maitresse: la mère pense à Mui comme sa fille) sont les thèmes universels dans le drame humaine.
Mais il y en a un message pour le public en regardant cette reconstruction d’un période historique du Vietnam. Le fait qu’il n’y en a aucun français dans cette film montre comment le Vietnam est en reconstruisant, complète avec les classes sociales ou les pauvres servent les riches. Mais les vestiges du colonialisme le diplôme du pianiste d’une école français, l’habillement de son fiancé, montre que l’ouest joue encore un rôle ici.
Le message sur l’identité vietnamienne, alors, est un peu compliqué. Enfin, on voit plusieurs identités vietnamiennes : celle de la vielle servante qui connait tous les trucs de la cuisine et la maison, la grand-mère qui croit obstinément dans son religion, la difficulté pour la mère d’être une bonne marie quand son mari l’abandonne, le pianiste qui adore la musique de l’ouest mais tombe amoureux d’une fille de la campagne vietnamien. Ils sont tous un partie de l’identité vietnemien, et ils jouent tous un rôle, s’ils le sachent ou non, en créant cette identité.
Lien au trailer: L'odeur du papaye vert